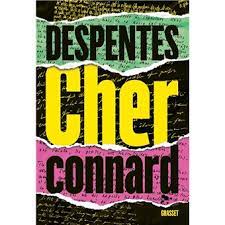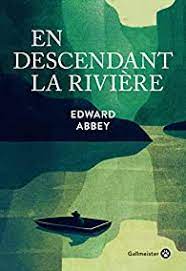Big Little Lies, saison 1, de Jean-Marie Vallée
You’re not perfect, welcome to the club !
Monterey, California.
Madeline vit avec Ed qui a le sex appeal d’un schtroumpf, elle est divorcée de Nathan qui a refait sa vie avec Bonnie. Avec Nathan, elle a eu Abigail, 16 ans, l’ado qui se cherche, et avec Ed, elle a eu le jeune Chloé, music-addict, presque plus mature que sa mère. La très belle Celeste est mariée au très beau Perry, ils ont des jumeaux adorables, blonds, insouciants – or so it seems- et ils vivent dans une maison de riches avec vue sur l’océan. Jane vit, elle, dans une maison carrée, moche, et élève seule son fils Ziggie -non, mais sans blague – fruit d’une relation non consentie et violente. Renata a une brillante carrière, elle est mariée au lourdaud Gordon et a une petite fille frêle aux grands yeux de chat effrayé, Amabella.
Quatre femmes dont la vie tourne autour de leurs enfants, de leurs problèmes de riches ou moins riches, de leur vie sexuelle, passionnelle ou frustrante ou inexistante. Elles sont insupportables, elles sont hystériques parfois, sous pression et drivées par la nécessité d’être des mères parfaites. Cette série montre bien la pression qui peut peser sur les épaules des femmes, épouses, mères, filles, et bien sûr l’omniprésente loi des apparences lorsque l’on vit dans une petite communauté ultra favorisée.
La série n’évite pas la caricature chez certains personnages, Reese Witherspoon est totalement crispante dans son rôle de Madeline, Nicole Kidman par contre est royale. J’ai trouvé que les séquences étaient vraiment répétitives mais que le dernier épisode plus enlevé était une excellente surprise et permettait d’envisager de regarder la deuxième saison …
Saison 2
Avalée en 24 heures, passionnante et passionnée. Une intrigue plus dense, riche et variée avec des personnages féminins joués par des actrices au sommet de leur art. Chacune fait face à ses propres démons et ses épreuves : Ed apprend que Madelin l’a trompé, et devient d’un coup très séduisant ; Renata pensait être tout en haut, mais Gordon est arrêté par le FBI pour fraudes, ils perdent tout ce qu’ils ont ; la vie de Bonnie est empoisonnée par le gros mensonge, elle se détache de Nathan et voit sa mère revenir dans sa vie ; Jane peine à faire confiance au très charmant collègue de travail qui est amoureux d’elle. Celeste, enfin, doit affronter le chagrin de la perte de son mari, le chagrin de ses deux enfants et la détresse de voir ma mère de Perry, s’introduire chez elle et tel un serpent, se retourner pour la mordre … Mary Louise (Meryl Streep, carte maîtresse) en effet ne veut rien de moins que récupérer la garde de ses deux petits-fils.
Dans cette série, tout est toujours une question de mensonges qui éclatent ensuite au grand jour, et font terriblement mal. Personne n’est en capacité de se taire, ni les enfants, ni les parents. Toute vérité n’est pas bonne à dire et dans ce microcosme qui passe son temps à tout se raconter, les psys ont de très beaux jours devant eux !
J’ai adoré cette saison d’une très grande qualité, j’ai bien ri (les scènes dans le bureau du directeur de Otter Bay School sont hilarantes), j’ai eu envie de pleurer devant la performance de Nicole Kidman. Je vais la retrouver dans The Undoing. Hâte